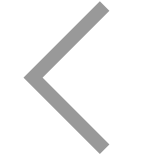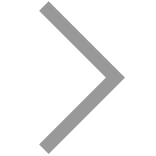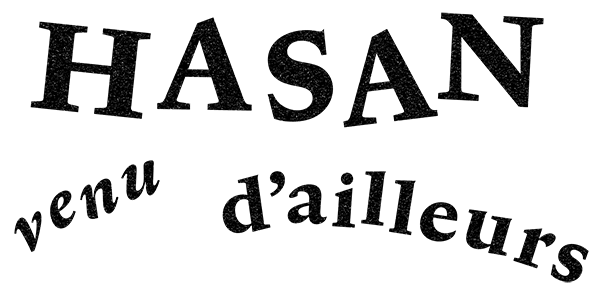
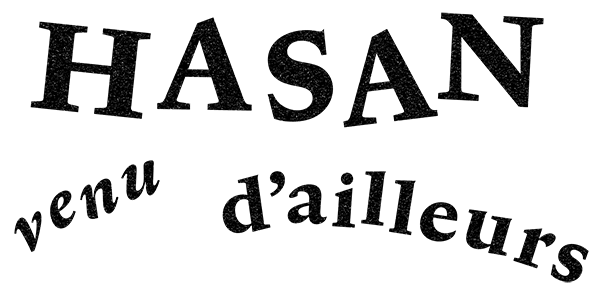
ACTIVITÉS
Sur cette page
- ACTIVITÉ 1 - Exploitation d’extraits de texte
- ACTIVITÉ 2 - C’est quoi, « un·e réfugié·e » ?
- ACTIVITÉ 3 - La vague ukrainienne de 2022
- ACTIVITÉ 4 - Lien avec les droits de l’enfant
- ACTIVITÉ 5 - Inverser la perspective, la Suisse comme terre d’émigration
- ACTIVITÉ 6 - Paul et Henriette en bateau
- ACTIVITÉ 7 - Lutter contre le racisme et la perspective « Eux et Nous »
- Annexes
ACTIVITÉ 1
Exploitation d’extraits de texte
Mes camarades disent qu’il est bizarre, Hasan.
Il ne sait pas écrire son nom,
il prend son repas assis par terre dans un coin de la pièce,
il mange souvent avec ses doigts.
Il y en a qui disent qu’il vient d’une autre planète,
qu’il ne sait rien faire.
- Inviter les élèves à relater un épisode de leur vie dans lequel l’Autre a été perçu comme « étrange », « différent », « surprenant » ou ayant suscité un malaise (exemples : le comportement non prédictible d’une personne présentant des troubles du spectre autistique, un garçon qui porte des vêtements féminins, le temps que prendrait une personne très âgée pour chercher sa monnaie à la caisse d’un magasin, …).
- Au-delà de l’effet de surprise (ou peut-être de rejet), émettre des hypothèses pour expliciter la situation (un enfant qui présente des troubles du spectre autistique peut réagir lorsqu’il est surstimulé au plan sensoriel, une personne assignée garçon à la naissance peut se ressentir fille et avoir envie de porter des vêtements féminins, prendre de l’âge ralentit les réflexes, …).
- Demander aux élèves d’exprimer ce dont ces personnes pourraient avoir besoin pour se sentir bien (respecter le fonctionnement d’une personne qui présente des troubles du spectre autistique, respecter le besoin individuel de se définir dans un autre genre que celui assigné à la naissance, rassurer la personne qui se sent en difficulté lorsque ses réflexes sont ralentis, …).
Ma famille vient d’un magnifique pays
où les fruits sont plus beaux
et les sourires plus lumineux que partout ailleurs.
On y tisse des tapis somptueux
sur lesquels on mange à même le sol les jours de fête,
en écoutant les histoires
que les Anciens partagent.
- Inviter les élèves à apporter en classe un objet (ou une photographie, qui pourrait être tirée de l’internet) qui illustre leur propre histoire familiale. À tour de rôle, chacun·e en explicite la symbolique.
- Sur le même modèle, chacun·e rédige un court texte poétique en s’inspirant de son histoire ou en l’inscrivant dans l’imaginaire. Illustrer le texte au moyen d’un dessin, d’une peinture ou d’un collage.
- Exposer les travaux dans l’école afin d’éveiller la curiosité des autres élèves de l’établissement.
« Ton nom ? Ton âge ? De quel pays tu viens ? »
À tour de rôle, nous avons répondu à plein de questions,
avant d’imprimer sur une grande feuille blanche
les empreintes de chacun de nos doigts.
- Les empreintes digitales : qu’ont-elles de particulier ? À quoi servent-elles ? Avec les plus jeunes, introduire le sujet en leur demandant d’apposer l’empreinte d’un de leurs doigts (le même pour toutes et tous, et de les comparer pour constater que chacune est unique).
- Créer une œuvre picturale à partir des empreintes : une empreinte peut prendre la forme d’un pétale de fleur, du corps d’un animal. Les applications sont multiples (voir notamment https://www.pinterest.de/vertcerise/dessin-avec-les-empreintes/). Créer une œuvre collective (association de travaux individuels ou composition commune) afin de visualiser la richesse engendrée par l’unicité de chacun·e.
En haut de la feuille, avec une craie,
il a écrit une phrase dans sa langue.
Hasan a rédigé cette phrase dans sa langue maternelle, le farsi.
Profiter ici de mettre en valeur les différentes langues présentes dans le groupe :
- Demander aux élèves d’écrire une phrase dans leur langue maternelle et demander au groupe d’en deviner la signification.
- Organiser un événement autour des livres multilingues (chaque élève apporte un livre dans sa langue puis raconte l’histoire en s’appuyant sur les illustrations afin que le groupe en comprenne le sens, visiter une bibliothèque interculturelle, …).
ACTIVITÉ 2
C’est quoi, « un·e réfugié·e » ?
Cette activité a pour objectif de mieux cerner ce que recouvre le terme «réfugié·e».
Les premières institutions internationales de protection des réfugié·e·s sont créées au sein de la Société des Nations (SDN), une organisation internationale introduite par le Traité de Versailles en 1919 afin de préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1921, le poste de haut-commissaire pour les réfugié·e·s russes fut ainsi confié à Fridtjof Nansen [1], explorateur et homme politique norvégien, qui a consacré le reste de sa vie à tenter de trouver des solutions aux multiples problèmes des réfugiés. Il s’est notamment investi dans la création d’un système de protection légale de ces réfugiés. Après son décès en 1930 fut créé l’Office Nansen afin de poursuivre son œuvre. En octobre 1938, un haut-commissariat unique pour l’ensemble des réfugiés sous la protection de la Société des Nations fut instauré et il fonctionna jusqu’en décembre 1946.[2]
Le terme « réfugié » est défini à l’article 1 de la Convention internationale relative au statut de réfugié adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaire sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1950.[3]
La Convention internationale relative au statut de réfugié·e a été adoptée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et a été ratifiée par 148 États sur les 194 membres que compte aujourd’hui l’ONU. Le sort des Juifs et des Juives face aux persécutions nazies avait montré la nécessité d’un tel outil.
La définition de « réfugié » ne s’appliquait initialement qu’aux événements antérieurs à 1951 survenus en Europe. Elle a été étendue en 1967 à travers un protocole supprimant les limites géographiques et temporelles. La Convention définit comme réfugié·e toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » art.1 et art.2 de la Convention relative au statut des réfugiés » (Jones, 2022, p.34) [4].
La notion de « migrant·e » est plus large, puisqu’il s’agit de toute personne quittant son pays pour s’installer dans un autre pays durant une période prolongée, pour y travailler, s’y marier, étudier, etc. A priori neutre, son usage s’est véritablement étendu dans les discours politiques et dans les médias depuis 2010 : on parlait auparavant plus volontiers d’ « immigré·e » ou « émigrant·e ». Le terme a été utilisé péjorativement pour délégitimer la présence des personnes étrangères sur le territoire national : « migrant·e économique » s’est ainsi substitué au qualificatif de « réfugié·e économique » ou celui de « faux réfugiés » fleurissant dans la rhétorique d’extrême droite.
À noter la connotation socio-économique de l’usage du terme migrant : sa définition devrait aussi logiquement s’appliquer aux travailleurs et travailleurs expatrié·e·s, fonctionnaires de la scène internationale. Dans le langage courant, on se limite à l’utiliser lorsqu’il est en lien avec une précarité économique que les personnes fuient.
S’ajoute à cela la question de la contrainte de l’exil. La protection internationale des réfugié·e·s est liée à une situation d’exil forcé en lien avec des persécutions et mises en danger politiques. Les contraintes liées à la survie, aux dérèglements climatiques, ne sont pas réglementées et incluses dans cette définition. Or, bien souvent les raisons de quitter son pays sont mixtes.
Contexte à l’échelle planétaire
Dans le monde, plus de 90 millions de personnes (soit près de onze fois la population suisse) fuient la guerre, la violence ou les persécutions. Chaque jour, des milliers de personnes sont contraintes d’abandonner leur domicile et leurs biens personnels parce que leur existence est menacée. Certaines fuient leur pays en quête d’un avenir meilleur dans un pays lointain, pour s’y reconstruire. D’autres sont déplacées dans leur propre pays ou se retrouvent dans un camp de réfugié·e·s proche de leur région [5]. Une personne sur huit est ainsi déracinée dans le monde.
Selon les statistiques de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 72% des personnes déracinées en 2021 étaient accueillies dans des pays voisins de leur pays d’origine. La même année, les trois quarts d’entre elles venaient des cinq pays suivants : Syrie, Venezuela, Afghanistan, Soudan du Sud et Myanmar.
Les pays du monde qui accueillent le plus de réfugié·e·s figurent pour certains parmi les plus pauvres. Par ordre décroissant, ces pays sont les suivants (les chiffres sont indiqués en millions) : Turquie (3,5), Colombie (1,73), Pakistan (1,44), Ouganda (1,42), Allemagne (1,21), Soudan (1,04), Liban (0,87), Bangladesh (0,87), Éthiopie (0,80) et Iran (0,80). La Suisse quant à elle figure en 36e position, avec un peu plus de 80 000 réfugié·e·s personnes accueillies [6].
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) rapporte que près de 25 000 personnes ont perdu la vie en tentant d’atteindre l’Europe en traversant la mer Méditerranée entre 2014 et 2021. [7]. Ce chiffre s’amplifie encore si l’on prend en compte, à l’échelle planétaire, les milliers de personnes qui décèdent durant la traversée du désert du Sahara, qui tentent de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ou lors de l’exode des Rohingya depuis le Myanmar. Les chiffres avancés ne sont pas toujours fiables, bon nombre de ces disparitions n’étant ni rapportées ni répertoriées.
La politique de plus en plus généralisée des états (les États-Unis, la Turquie, le Maroc, l’Algérie, l’Autriche, la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, l’Inde, la Jordanie, le Kenya, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, le Pakistan, la Tunisie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et la Norvège, pour n’en citer que quelques-uns) consiste à « se protéger » en construisant des murs, ce qui incite les personnes migrantes à emprunter des chemins de plus en plus dangereux pour les contourner. En Europe, depuis la mise en œuvre de l’espace Schengen en 1995, la libre circulation est assurée à l’intérieur de 26 pays européens – dont la Suisse –, mais le contrôle des frontières extérieures est renforcé. En 2013, un accord est passé avec le Maroc afin d’empêcher l’accès à Melilla. En mars 2016, l’Union européenne et la Turquie adoptent un accord introduit deux jours plus tard. Moyennant financement, la Turquie s’engage à freiner le flux des migrant·e·s qui tentent de gagner la Grèce depuis ses côtes, mais aussi d’accepter le retour de ressortissant·e·s syrien·ne·s dans le cadre d’un processus de réinstallation. Cet accord n’a pas, à ce jour, fait ses preuves. Le même type d’accord est signé avec la Turquie, soutenu par un subside de trois milliards d’euros. Aux États-Unis, le gouvernement a renforcé sa police d’immigration, ce qui a causé ces dernières années la mort de centaines de personnes dans les zones frontalières désertiques et dans des camions de passeurs.
Ces politiques dissuasives n’ont néanmoins pas réussi à empêcher les flux migratoires, tout simplement parce que ces migrations ne sont pas choisies mais engendrées par des conditions de vie inhumaines. [8]. Par contre, ce manque de soutien aux migrant·e·s se solde périodiquement par des drames qui auraient pu être évités: à Calais (27 victimes qui tentaient de rejoindre l’Angleterre en traversant la Manche en novembre 2021), au large de Rhodes en Grèce (50 personnes disparues lors du naufrage de leur bateau), au Texas (51 personnes décédées dans un camion surchauffé en juin 2022). La liste n’est pas exhaustive.
Il revient à chaque État de mettre en place une « procédure de détermination du statut de réfugié·e·s », qui vise à octroyer aux personnes venues demander l’asile la protection internationale dont elles ont besoin.
En Suisse, le Secrétariat d’État aux migrations est l’autorité chargée de cette procédure d’asile au terme de laquelle les requérant·e·s d’asile se voient attribuer un statut (lequel peut également prendre la forme d’un refus d’entrée en matière ou d’un refus). C’est la Loi sur l’asile (LAsi) établie en 1998 qui définit les conditions d’octroi et les statuts. Cette loi, très souvent attaquée par les partis xénophobes, a été révisée à de nombreuses reprises, souvent dans le sens d’un durcissement.
Dans sa définition du/de la réfugié·e, la Convention de Genève (article 1, A, 2 de la Convention du 28 juillet 1951) retenait cinq grandes catégories de raisons qui sont aujourd’hui encore reconnues pour avoir une chance d’obtenir l’asile et devenir un·e réfugié·e statutaire : la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social et les idées politiques (ces catégories sont détaillées en annexe 1). Si d’autres causes peuvent justifier une protection internationale (celles notamment liées au dérèglement climatique ou à la faim dans le monde), elles peinent néanmoins à être prises en compte. À noter également que les raisons qui poussent à l’exil sont souvent multiples.
La question des frontières
Notre façon d’envisager un monde marqué par des frontières est ancrée dans l’histoire européenne : après la guerre de Trente Ans – qui causa la mort d’un quart de la population – le traité de Westphalie renforça l’idée de recourir à la souveraineté territoriale, inscrite sur des cartes. La frontière est devenue un lieu clé où se joue la force de l’État. Le concept ne va ainsi pas de soi, pas plus que les tracés eux-mêmes, qui parfois regroupent sans aucune cohérence des peuples qui ne se reconnaissent pas ou alors séparent des peuples frères.
Un jour, « refuser une égale protection en se fondant sur le lieu de naissance paraîtra peut-être aussi anachronique et répréhensible que le fait de refuser des droits civiques en se fondant sur la couleur de peau, le genre ou l’orientation sexuelle » (Jones, 2022, p. 211). Il est certain que si les frontières s’ouvrent maintenant aux capitaux et aux biens de consommation, elles demeurent souvent fermées aux travailleurs et travailleuses, et maintiennent de très fortes inégalités.
Aborder la question de l’asile avec de jeunes enfants est complexe. Le numéro du P’tit Libé – L’actu des grands expliquée aux enfants – consacré à la crise migratoire de 2015 permettra d’introduire le sujet.
Activité proposée :
L’annexe 2 présente la situation de quelques personnes en fuite et qui déposent une demande d’asile. En préambule :
- Les élèves prennent connaissance des critères reconnus tels que définis par la Convention internationale relative aux statuts des réfugié·e·s (annexe 1).
- La définition des termes requérant·e d’asile (personne qui demande l’asile), réfugié·e statutaire (personne qui a obtenu l’asile), et requérant·e d’asile débouté·e sera explicitée. Le glossaire réalisé par Vivre Ensemble fournit de précieuses informations à ce niveau : https://asile.ch/memots/
- En petits groupes, les élèves complètent le tableau : Les critères pour obtenir l’asile sont-ils remplis ? Quelle décision sera vraisemblablement rendue ? Qu’en pensent les élèves ?
Prolongement : imaginer d’autres situations, tirées de l’expérience des élèves, des informations véhiculées par les médias, imaginaires, puis en discuter en les analysant selon la même approche.
NOTES
[1] https://www.ofpra.gouv.fr/node/370
[2] https://www.ofpra.gouv.fr/node/370/
[3] http://www.unhcr.org/fr/4bea748d6.pdf
[4] Jones, R., (2022). La violence des frontières, Les réfugiés et le droit de circuler. Eliott Éditions.
[5] Source : UNHCR, 2021 et 2018.
[6] Liste complète disponible ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_nombre_de_r%C3%A9fugi%C3%A9s
[7] https://data.unhcr.org/fr/situations/mediterranean
[8] De nos jours, une personne sur six vit dans un bidonville.
ACTIVITÉ 3
La vague ukrainienne de 2022
Le 15 février 2021, la guerre éclatait en Ukraine. Une semaine plus tard, près de 1 million de civils, majoritairement des femmes et des enfants, ont fui en direction des pays limitrophes, puis dans toute l’Europe. Ces personnes bénéficient d’un libre accès à l’Union européenne et à l’espace Schengen où elles peuvent séjourner trois mois ou plus.
Les pays de l’Union européenne se sont engagés à leur offrir un permis de travail, l’accès à l’aide sociale, aux soins et à l’éducation, de même que, sous certaines conditions, le droit au regroupement familial. La Suisse, pour sa part, a activé pour la première fois le permis S, un statut provisoire qui garantit pratiquement les mêmes droits.
Trois mois après le début de la guerre [1], 6 millions de ressortissant·e·s d’Ukraine étaient en fuite. Cinquante mille ont trouvé refuge en Suisse. Il s’agit du plus important mouvement de population en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) fournit des informations actualisées régulièrement sur l’évolution de ce conflit et de ses conséquences pour la population ukrainienne.
1jour1actu, l’actu à hauteur d’enfants (Éditions Milan) fournit des informations accessibles dès 8 ans dans un numéro spécial téléchargeable gratuitement ici.
Déroulement de l’activité proposée
Recommandation : cette activité n’est pas à proposer dans une classe qui accueille des élèves venant d’Ukraine.
Discussion libre :
Que savent les élèves sur la guerre en Ukraine ? Quelles en sont les conséquences ? D’où viennent les informations rapportées ?
Est-ce que les élèves connaissent des populations concernées et accueillies ? Comment cet accueil s’est-il déroulé ? Qu’en pensent les élèves ?
Visionner le court documentaire: MONDE : Réfugiés ukrainiens : où iront-ils ? du 4 mars 2022 (4,49 min)
Questions à discuter :
Qui sont majoritairement les personnes qui fuient et pourquoi ? Des femmes et des enfants, les hommes de 16 à 60 ans étant obligés de combattre.
Comment se déplacent-elles et pourquoi ? L’espace aérien étant fermé, ces personnes se déplacent en train, en voiture ou à pied.
Dans quels pays se rendent-elles et pourquoi ? D’abord dans les pays limitrophes pour des raisons de proximité (Pologne, Hongrie, Moldavie, Slovénie, Russie), puis dans le reste de l’Europe. Elles se rendent surtout dans des pays où la communauté ukrainienne est fortement représentée.
Une semaine après le début de la guerre, la Suisse accueillait 7000 personnes réfugiées. Combien sont-elles aujourd’hui ? Près de 60 000 au 5 août 2022 (source : RTS info).
Comment l’accueil s’est-il organisé dans l’Union européenne et en Suisse ? Dans un premier temps, ces personnes ont été accueillies par des particuliers, avant d’être placées dans des appartements. Elles ont bénéficié d’un permis de travail, d’un accès à l’aide sociale, aux soins, à l’éducation et, sous certaines conditions, au regroupement familial. (Complément d’information à fournir : en Suisse, un permis S a été délivré, qui garantit pratiquement les mêmes droits. C’est la première fois que ce permis est délivré depuis son introduction en 1999.)
Les mêmes droits ont-ils été accordés à toutes les personnes fuyant l’Ukraine ? Non. Les personnes étrangères qui étaient en Ukraine (les étudiants, africains notamment) ont été victimes de discrimination et n’ont pas eu accès à la même protection.
En Suisse, l’accueil réservé aux personnes réfugiées ukrainiennes est-il offert aux populations réfugiées qui viennent d’autres pays ? Non. Le permis S n’est délivré qu’aux ressortissant·e·s d’Ukraine. Les autres doivent suivre une procédure d’asile beaucoup plus longue, qui aboutit souvent à un refus. Durant ce temps, ces personnes vivent dans des centres de requérant·e·s d’asile, n’ont accès ni au travail, ni à la formation (exception faite des enfants qui sont scolarisés), ni à l’aide sociale. L’accès aux soins est limité. Le regroupement familial n’est pas autorisé.
Débat : la Suisse a démontré qu’elle était capable de mettre en place très rapidement des mesures pour accueillir dignement une population menacée. Serait-il envisageable d’en faire bénéficier d’autres populations ?
NOTES
[1] https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-88941.html
ACTIVITÉ 4
Lien avec les droits de l’enfant
Cette activité a pour objectif d’établir un lien entre l’histoire d’Hasan et les droits de l’enfant. Tout droit étant associé à un devoir, l’objectif est également d’identifier les devoirs de chacun·e pour favoriser le respect de ces droits.
Démarche proposée :
- Oralement, demander aux élèves de définir ce qu’est un droit, puis élargir la réflexion aux droits de l’enfant.
La courte vidéo suivante permettra d’expliciter le cadre juridique de la Convention internationale des droits de l’enfant signée par de nombreux pays en 1989 sous l’égide de l’ONU :
Un jour – une question : C’est quoi les droits de l’enfant ?
- Distribuer le document Les 10 principaux droits de l’enfant disponible ici.
- Mettre en lien ces droits avec l’histoire d’Hasan. Ont-ils été respectés ?
- Qu’en est-il aujourd’hui, alors qu’il vit dans un nouvel environnement ?
- Quels devoirs cela implique-t-il pour la société d’accueil ? Le groupe classe ?
- Individuellement, les élèves choisissent le droit qui leur semble le plus important pour permettre à Hasan d’être respecté. Chaque enfant met ensuite ce droit en scène sous forme de dessin, en faisant figurer Hasan dans sa production.
- Prolongements :
À l’occasion de la journée des droits de l’enfant du 20 novembre, la fondation Éducation21 réalise chaque année un dossier pédagogique sur des thèmes divers. Ces documents sont disponibles ici.
La Conférence romande des Bureaux de l’égalité (egalite.ch) met à disposition quatre ouvrages proposant de nombreuses activités pédagogiques pour intégrer les questions de genre à son enseignement·e. Le matériel pédagogique L’école de l’égalité est composé de quatre brochures s’adressant à l’ensemble de la scolarité obligatoire (de la 1re à la 11e année). Ces brochures proposent des activités en lien avec le Plan d’études romand et les disciplines scolaires.
Elles peuvent être téléchargées librement ici.
ACTIVITÉ 5
Inverser la perspective, la Suisse comme terre d’émigration
Cette activité a pour objectif – dans une perspective historique – de démontrer que le choix ou le besoin d’émigrer a aussi été une réalité en Suisse. Ainsi, les migrant·e·s originaires de Suisse ont également été les « Autres » dans plusieurs pays d’accueil. Si leurs conditions de vie et les motivations les ayant amené·e·s à partir n’étaient pas identiques à celles qui poussent aujourd’hui des hommes, des femmes et des enfants sur les routes de l’exil, elles n’en demeurent pas moins similaires, ce qui nous permet de concevoir une réalité commune.
En déplaçant la focale, cette activité vise à amener l’élève à plus d’empathie, soit à se mettre à la place de l’Autre et à comprendre qu’il ou elle aurait pu être l’enfant sur les routes dans un autre temps, pas si lointain pourtant.
Nous avons retenu ici, afin d’exemplifier cette thématique, l’émigration des Suisses vers l’Argentine, qui fut l’une des plus importantes à partir de notre pays. La proximité temporelle – certes toute relative pour les élèves – permet une identification plus facile avec les personnages du récit fictif, servant de base à cette activité.
Le contexte social ayant engendré l’immigration en Suisse
Nous proposons ici de présenter oralement ce contexte aux élèves. On peut aussi leur demander de parler avec leurs grands-parents, qui auraient peut-être encore un récit à raconter, une histoire de famille à partager, ce qui permettrait d’apporter une dimension intergénérationnelle à cette activité, tout en inscrivant quelques élèves de façon personnelle dans l’histoire humaine de la migration. Les photos issues du site ci-dessous pourraient constituer une accroche :
De 1847 à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, une importante émigration suisse s’est dirigée vers l’Argentine. La Suisse, dont le niveau de vie d’aujourd’hui est appréciable, comptait alors parmi les pays d’Europe les plus pauvres et bon nombre de ses citoyen·ne·s vivaient dans une grande précarité. Plus particulièrement dans les régions montagneuses, des hommes et des femmes souffraient de la faim. Les communes voulant éviter que trop de personnes ne requièrent l’aide sociale – ce qui aurait constitué un poids financier important à l’époque – encouragèrent cet exil en finançant le voyage des « volontaires ». En cas de retour, cette aide devait être remboursée, mesure pour le moins dissuasive qui incitait les indésirables – nous entendons ici les « cas sociaux » pouvant amener des tensions au sein des communautés helvétiques – à rester à l’étranger, quelles que soient les difficultés rencontrées. En 1936, la Confédération suisse crée même un « Bureau central suisse de colonisation d’outre-mer » qui fournit des prêts remboursables aux candidats suisses à l’émigration. L’Argentine, pays encore jeune, cherchait de la main-d’œuvre afin de mettre ses terres en valeur. Les émigrant·e·s européen·ne·s étaient privilégié·e·s, dans la politique d’accueil de l’Argentine qui offrait des terres ou les vendait à moindre coût (même si de mauvaises surprises attendaient aussi les migrant·e·s à l’arrivée!). Ainsi, environ 40'000 citoyen·ne·s suisses partirent vers différentes régions d’Argentine. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette émigration s’interrompit : les Suisses préférèrent s’exiler dans les pays d’Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pour des motifs essentiellement économiques, une grande partie des Suisses et des Suissesses exilé·e·s ont également quitté l’Argentine où il reste entre 15'000 et 20'000 personnes issues de l’émigration provenant de notre pays.
Après la présentation de ce contexte aux élèves, on pourrait les amener à réfléchir aux questions suivantes (qui pourraient se poser aussi pour Hasan, ses ami·e·s et ses concitoyen·ne·s demandant aujourd’hui l’asile en Europe) :
- Pourquoi des Suisses émigraient-ils vers l’Argentine ? Peut-on ici parler de migrant·e·s politiques ou économiques ?
- Quelle a été l’attitude de la Suisse envers ces personnes ? Pourquoi certaines étaient-elles « indésirables » ?
- Quel a été l’accueil réservé par l’Argentine ? Pourquoi ? En quoi une main-d’œuvre supplémentaire peut-elle être bénéfique pour un pays ?
- Pour quelle raison les personnes suisses avaient-elles choisi l’Argentine ? Pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, choisissent-elles d’autres terres d’exil ?
Pour aller plus loin :
- En quête d’espérance – l’émigration suisse en Argentine, soliswiss.ch
- 1855 : Premiers départs pour l’Argentine, emigration-valais.ch
- Les 125 ans des colonies Esperanza, San José et San Jeronimo en Argentine; un aspect de l'émigration valaisanne outre-mer au XIXe siècle, core.ac.uk, PDF, 24 p., 10.6 Mo
ACTIVITÉ 6
Paul et Henriette en bateau
Le récit fictif de Paul et Henriette, jeunes enfants valaisans ayant dû émigrer avec leur famille durant les 19e et 20e siècles, présente une histoire qui « fait miroir » à celle d’Hasan afin de renverser notre perspective du « Nous et les Autres ».
Nous nous proposons ici d’exploiter l’extrait du journal intime d’Henriette, disponible en annexe 3.
Les questions suivantes peuvent être discutées avec les élèves après la lecture:
- Pourquoi les parents ont-ils décidé de partir ? Quels étaient les sentiments de la mère avant le départ ?
- Pourquoi Henriette a-t-elle peur à Bordeaux et sur le bateau ? Comment les deux enfants essaient-ils de se rassurer ? Qu’auriez-vous fait ?
- Qu’est-ce qui était difficile pendant la traversée de l’océan ?
- Quelle mauvaise nouvelle attend la famille à son arrivée en Argentine ?
- Qui partage le même sort que les communautés suisses arrivées à Buenos Aires ? Pourquoi ont-ils peint leurs maisons ?
- À ton avis, que va-t-il se passer avec Henriette et sa famille ?
ACTIVITÉ 7
Lutter contre le racisme et la perspective « Eux et Nous »
Les comportements racistes ou discriminants au sein d’une classe – tout comme dans la société au sens large – reposent sur la construction de catégories, que l’on imagine homogènes et donc fondées sur des stéréotypes ; ces catégories sont organisées dans un rapport hiérarchique dont usent certain·e·s afin de marquer leur pouvoir sur d’autres. Ainsi, si le concept de race n’est plus valide scientifiquement aujourd’hui et que nous faisons tous partie d’une même espèce humaine, la race comme construction sociale existe bel et bien et son invalidité doit être démontrée afin de la déconstruire et d’en annuler les effets négatifs et destructeurs.
Lutter contre ces discriminations demande de reconnaître le pluralisme culturel et de valoriser la diversité – afin de combattre les rapports hiérarchiques et les visions ethnocentriques – qui doit être pensée comme la norme, de façon équitable.
Comme toute activité menée dans le cadre d’une pédagogie antiraciste, il ne s’agit jamais de culpabiliser mais de responsabiliser (en insistant par exemple sur le rôle du témoin, ou « bystander »). Si la responsabilité de chacun·e est importante afin de lutter contre les discriminations, on doit aussi rendre compte du racisme systémique, qui marque la société et les institutions, ce qui demande une restructuration de plusieurs aspects de notre société, de nos systèmes éducatifs (sélection renforçant les discriminations, faible représentation des professeur·e·s non blancs, etc.). La lutte contre le racisme dépasse ainsi la prise de conscience individuelle, même si celle-ci est très importante.
Essentiellement à travers le dialogue et l’écoute active, les élèves doivent être sensibilisé·e·s aux expériences de leurs camarades dans une attitude de respect mutuel [1]. Il ne s’agit ainsi pas d’éduquer contre le racisme mais « de créer des occasions où l’on peut se former, s’exprimer, douter, s’interroger et interroger les autres, un lieu où il est aussi question d’écoute, de rencontre » (Eckmann & Davolio, 2017, p. 21) [2]. Des activités telles que des jeux de rôles permettent aussi d’amener une démarche pédagogique qui mobilise l’empathie et l’intelligence émotionnelle.
Proposition 1 : éviter l’enfermement des élèves dans des « cases » culturelles :
S’il est important de valoriser chaque culture présente au sein de la classe – l’approche par une démarche plurilingue étant par ailleurs une voie très pertinente – il faut aussi poser l’identité de chacun·e comme étant plurielle et en constante évolution. L’élève doit ainsi être amené·e à s’affirmer comme l’acteur·trice de sa propre identité en perpétuelle renégociation.
Ainsi, si pour certain·e·s élèves la référence à une appartenance culturelle représente un facteur important de leur définition identitaire, d’autres préféreront ne pas mettre en avant cette différence et il ne faudrait pas au nom d’une « ouverture culturelle » forcer cette assignation.
Il y a autant d’élèves migrant·e·s différent·e·s que d’élèves non migrant·e·s différent·e·s et l’Autre nous ressemble aussi sous plusieurs aspects. La vision dichotomique « Eux » et « Nous » ne correspond pas à la réalité. Le rôle de l’école est ainsi d’amener l’élève à se penser de façon protéiforme et à se repenser librement en construisant ainsi des ponts et non des murs entre les autres et lui.
L’activité « Les facettes de mon identité » permettra aux élèves de prendre conscience de leur richesse identitaire, puis de réaliser qu’au-delà de leurs différences, chacun·e partage souvent avec l’Autre l’une ou l’autre facette de son identité.
Déroulement de l’activité (annexes 4 et 5)
- En groupe classe, nommer les différents éléments qui constituent l’identité individuelle (l’origine, la langue, les intérêts, les rêves…).
- Expliciter le concept de « fleur interculturelle » (Balenci, T. & Bialato, L., 1987) et utiliser l’annexe 4 (Les facettes de mon identité complétée) pour illustrer la démarche.
- Distribuer à chacun·e un exemplaire de l’annexe 5. Leur demander d’inscrire leur prénom dans le cercle central, puis de compléter les différentes rubriques.
Quelques pétales sont vierges : libre à chacun·e de les utiliser pour exprimer une facette qui leur est importante. - Les fiches une fois complétées, inviter les élèves à se déplacer dans la classe et comparer leur profil identitaire avec celui de leurs camarades (observation des différentes productions). L’intérêt de l’activité réside dans les partages informels qui en découleront (surprise en constatant que certaines personnes, a priori très différentes de nous, ont relevé des facettes similaires aux nôtres… La découverte de certaines facettes méconnues chez des personnes que l’on croit bien connaître…).
Mise en commun
La discussion mettra en évidence que les appartenances se croisent et qu’aucun des critères pris en compte ne permet de créer une catégorie homogène.
Elle permettra sans doute également de modifier la perception que les élèves ont d’eux-mêmes, des autres, de quelques autres en particulier.
Prolongement possible
Établir un parallèle avec la diversité observée dans un autre domaine, celui des végétaux ou du monde animal par exemple. Utiliser à cet effet l’annexe 6. Au centre, inscrire le thème choisi. Décliner dans les différents pétales les éléments qui pourraient en illustrer la diversité.
Proposition 2 : appartenance à une humanité commune
Nous chercherons ici, en reprenant l’histoire de Hasan venu d’ailleurs et l’extrait du journal intime d’Henriette (annexe 3), à identifier les besoins communs (manger, être accepté·e, …) aux deux jeunes, ainsi que les sentiments et émotions qu’ils partagent (peur, …).
Les élèves seront également encouragé·e·s à exprimer leurs éventuelles expériences de stress, de même que les résonnances que les deux récits présentés occasionnent peut-être [3].
Suggestions de questions à poser :
- Que manquait-il à Hasan et à Henriette dans leur pays d’origine ?
- Qu’espéraient trouver les deux enfants au bout du chemin de l’exil ?
- Quelles ont été les compétences à développer afin de pouvoir s’intégrer ?
La mise en parallèle des deux textes vise aussi à relever quels sont les rapports dissymétriques sous-jacents aux discriminations et quels sont les rapports de force en présence.
On pourra aussi relever que ces rapports évoluent. Il fut un temps où les Suisses s’exilaient pour survivre ; ils et elles doivent désormais se positionner par rapport à l’accueil d’autres personnes menacées.
Conclusion
La première proposition permet de montrer que nous appartenons tous et toutes à des subcultures, que les lignes de partage se croisent et que les différences sont tout aussi présentes dans l’intragroupe que dans l’intergroupe.
La seconde met en évidence les attentes communes à tous les êtres humains.
Le racisme se base ainsi sur une existence illusoire de groupes homogènes et distincts et s’appuie sur une situation hiérarchique prévalant à un moment donné dans une société. Il n’est ainsi ni une évidence ni une fatalité !
NOTES
[1] Les interventions menées par l’association Prophilo s’appuient sur une démarche permettant d’instaurer au sein des classes un dialogue constructif et porteur d’écoute mutuelle et cela également avec des enfants en âge primaire.
[2] Eckmann, M. & Eser Davolio, M. (2017). Pédagogie de l’antiracisme : aspects théoriques et supports pratiques. Éditions ies.
[3] Eckmann, M. & Eser Davolio, M. (2017). Pédagogie de l’antiracisme : aspects théoriques et supports pratiques. Éditions ies.
ANNEXES
- ANNEXE 1 - Catégories reconnues pour obtenir l’asile
- ANNEXE 2 - Ces personnes espèrent obtenir l’asile… Vont-elles y arriver ?
- ANNEXE 3 - Extrait du journal intime d’Henriette
- ANNEXE 4 - Les facettes de mon identité (exemple d’illustration)
- ANNEXE 5 - Les facettes de mon identité
- ANNEXE 6 - La diversité du monde qui m’entoure